Article(s) associé(s)
- Tsípras prend le risque d'un affrontement avec l'Europe
- La Grèce et ses créanciers dans l'obligation de s'accorder rapidement
- Grèce : Yanis Varoufakis souhaite un accord global d'ici à fin mai
L'arrivée au pouvoir de la « gauche radicale » grecque a frappé les esprits européens par trois minirévolutions : un bannissement général des cravates, l'affichage d'une laïcité revendiquée et... un certain machisme, le gouvernement ne comptant que 6 femmes pour 33 hommes. Mais la rupture la plus importante et la plus dérangeante pour l'Europe se situe évidemment ailleurs : dans la demande du nouveau Premier ministre, Aléxis Tsípras, de renégocier la dette et d'abandonner le programme d'austérité qui lui est intimement lié. La position du gouvernement a été résumée clairement par son ministre des Finances, Yánis Varoufákis. Tout juste nommé, ce dernier a expliqué à la BBC que « en Grèce, la question de l'insoutenabilité de la dette avait été traitée comme un problème de liquidité ». En d'autres termes, c'est parce que la dette grecque a été considérée à tort comme soutenable en 2010 que les Européens et le FMI ont soumis la Grèce à un traitement de choc qui s'est révélé non seulement fatal pour la croissance et la cohésion sociale, mais aussi contre-productif : loin de provoquer le coup de fouet espéré, la déflation interne a fait plonger la Grèce dans une profonde récession. Le pays a perdu un quart de sa richesse produite et le chômage a explosé.
Jusqu'à présent, les dirigeants européens ont fait la sourde oreille. Le fait que cette demande de renégociation de la dette émane de « la gauche radicale », peu crédible sur le plan économique et politiquement inexpérimentée, a pu autoriser les gouvernements européens à prendre de haut ses deux principaux émissaires : Aléxis Tsípras et Yánis Varoufákis. De Paris à Berlin, on les a qualifiés au mieux de « doux rêveurs », au pire de dangereux irresponsables prêts à menacer les contribuables allemands et français.
Pourtant, la Grèce ne manque pas d'arguments pour réclamer une remise à plat des conditions de remboursement de sa dette. Ils ont été livrés au fil du temps par les experts du FMI eux-mêmes et au plus haut niveau.
En juillet 2012, quelques mois après la mise en place d'un deuxième plan de soutien à la Grèce, l'ex-représentant du pays au Fonds, Panayotis Roumeliotis, aujourd'hui vice-président de la Banque du Pirée, révèle au « New York Times » que le débat a fait rage au début de la crise grecque en 2010 sur la soutenabilité de la dette. « Nous savions dès le début que ce programme était impossible à mettre en oeuvre », notamment parce que, la Grèce étant dans l'euro, elle ne pouvait pas dévaluer. Le FMI a fini par accepter de financer le programme grec, parce que le risque systémique lié à la contagion de la crise grecque était très élevé. Il a quand même fallu changer les statuts du Fonds pour déroger aux règles qui exigent qu'un pays ne peut être aidé que s'il est solvable.
Quelques mois plus tard, en octobre 2012, le FMI livre un autre aveu : il a sous-estimé l'impact des plans d'austérité dans les pays sous programme de la zone euro. L'économiste en chef du Fonds, Olivier Blanchard, fait un discret mea culpa dans le rapport économique annuel, en reconnaissant que les « multiplicateurs » utilisés pour mesurer l'effet des politiques d'assainissement budgétaire sont en réalité bien plus importants qu'escompté.
A ce moment-là, la Grèce est en train de vivre sa cinquième année de récession, 2012 se terminant sur un recul du PIB de 6,6 %. Etrangement, cet acte de contrition ne va rien modifier à la politique budgétaire appliquée en Grèce : les revues de la troïka se poursuivent avec la même sévérité. Lors des dernières négociations avec le gouvernement Samaras à l'automne dernier, la troïka exigeait encore de réduire le niveau des retraites dans le but de dégager le surplus budgétaire inscrit dans le mémorandum d'aide.
L'autocritique la plus spectaculaire du FMI émane de l'ancien directeur de son département Europe. Jusqu'en juillet 2014, c'est lui qui supervisait, de Washington, les négociations entre la troïka et les autorités grecques. Dans une « opinion » publiée par le « Financial Times » le 25 janvier, Reza Moghadam affirme que « les plans actuels pour porter l'excédent primaire de 1,5 % à 4,5 % à partir de 2016 », dans le but de rembourser rapidement la dette, « menaceraient la cohésion sociale qui anéantirait toute chance de reprise économique ». « Politiquement, c'est hors de portée », assure-t-il. Dès lors, il propose ce qu'il s'est bien gardé de suggérer lorsqu'il était au FMI : « la réduction de moitié de la dette grecque » ! Au passage, il crédite le parti Syriza d'une virginité politique qui pourrait rendre la nouvelle équipe plus efficace dans sa lutte contre l'évasion fiscale et la réforme de l'administration.
Il y aurait donc deux vérités s'agissant de la Grèce : l'une, immanente, à laquelle on s'accrocherait quand on est à l'intérieur du système de la troïka, au nom de la stabilité financière de la zone euro et de l'aléa moral. Il faudrait alors imposer coûte que coûte un régime draconien à un pays potentiellement insolvable. Et l'autre, qu'on dévoilerait d'urgence dès qu'on est sorti des cénacles officiels pour faire savoir à ceux qui n'ont aucun pouvoir de changer les choses que l'acharnement thérapeutique appliqué à la Grèce mène tout droit dans le mur.
La simple reconnaissance par le FMI de ses nombreuses erreurs justifierait à elle seule la remise à plat du programme de soutien à la Grèce, réclamé aujourd'hui par Aléxis Tsípras. Même si cela oblige les dirigeants européens eux-mêmes à un douloureux examen de conscience.
Catherine Chatignoux
Chef-adjointe du service Monde
En savoir plus sur
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204146896346-lentetement-coupable-du-fmi-face-a-la-crise-grecque-1092115.php?Lufd6Xwi0eYFq85X.99























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































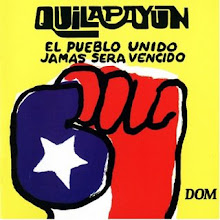.jpg)




























































































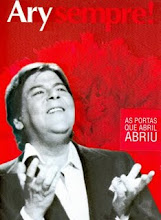










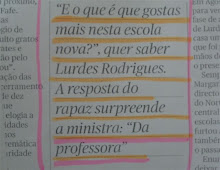






















































































































































































Sem comentários:
Enviar um comentário